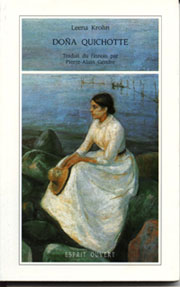
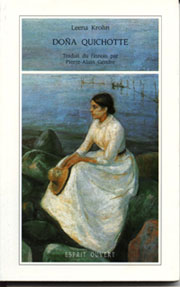
DOÑA QUICHOTTE ET AUTRES CITADINS:
Portraits
(WSOY, 1983, ESPRIT OUVERT, 1998)
Traduction de Pierre-Alain Gendre
Ne crée pas d'images. Tout est.
Mirkka Rekola
TABLE
LE MOINEAU
BRIN DE PAILLE
LÀ OÙ VOUS ÊTES
L'ÉCLAT DU VERRE
DOÑA QUICHOTTE
LE CORTÈGE
UTA ET ECKHART
L'ENFANT CRO-MAGNON
LA TOUR
LA MOMIE
MOZART NOUS A TROMPÉS!
LA CHAMBRE DU TEMPS
PATROCLE AUSSI EST MORT
LE CYPRÈS DU SOLEIL
L'AUTRE ET LA NUIT
LA CELLULE
LE SOUVENIR DE NOS GESTES
L'ENFANT-MIROIR
LA LAMPE DE L'AQUARIUM
LA CHAMBRE VIDE
LE CORDEAU DE ZOROBABEL
LE MOINEAU
Je n'ai pas oublié que parmi les rochers du parc j'ai marché sur un oiseau
blessé. Ses faibles mouvements sous le talon de ma chaussure, sa douceur
absolue.
Lorsque j'ai relevé le pied, il est encore parvenu à voleter vers une
pierre sous un tilleul. Nous l'avons suivi et, devant nous sur le granit,
il a enfoui son bec dans son plumage et n'a plus bougé.
"Un petit moineau et une grande paix," a dit Doña Quichotte.
C'était le premier jour de l'automne, le temps avait changé. Au-delà des
tilleuls, la perspective bleue des nuages s'assombrissait.
"L'hiver, nous pourrons skier jusqu'à ces îles, à moins que je ne sois ce
moineau," a-t-elle dit.
Pourquoi disait-elle cela? J'ai senti à nouveau la souffrance sous mon
ta-lon, comme s'il s'était agi d'un visage humain.
Plus tard, comme nous longions le rivage, nous entendîmes un choeur chanter
sans relâche; des voix hautes et claires de femmes ou de jeunes gar-çons.
C'était un air jamais entendu de personne prove-nant des mâts et des
cordages des bateaux du club nautique.
Lorsque le ciel s'obscurcit, je m'assombris moi aussi.
"Qu'as-tu?" me demande Doña Quichotte.
"Je n'en peux plus," lui dis-je. "Je ne peux vraiment plus le supporter."
"Et que te faut-il donc supporter?" me demande-t-elle, et je réponds:
"Vivre encore trente, quarante ou cinquante ans sur cette étoile de
fumier."
"Tu mériterais une correction," dit Doña Quichotte. "Il ne s'agit pas d'années."
"Pas d'années?" m'exclamé-je.
"Non," dit Doña Quichotte. "Ce sont des jours."
Je fais le calcul: quarante années signifient dix-sept mille six cents
cou-chers de soleil.
"Quand tu les auras tous vus," dit Doña Quichotte, "es-tu bien sûre de
vouloir en voir encore et encore et encore"
BRIN DE PAILLE
L'hiver avait été rude et une brume d'indifférence m'enveloppait depuis
longtemps. Une sorte de pellicule recouvrait ma langue, au point que tout
dans ma vie avait perdu son goût. Quand je voulais saisir quelque chose, ma
main était paralysée. Une substance poisseuse m'isolait du monde.
C'est au début de ce printemps-là que je fis la connaissance de Doña
Quichotte. Où était-ce donc? Là-bas, sur cette haute colline d'où on a vue
sur la ville, le port et la mer.
Alors que j'étais assise sur le socle d'une statue, une étrange apparition
passa devant moi, mince et élancée comme un brin de paille, et se déplaçant
avec tant de légèreté qu'on aurait dit qu'elle glissait au-dessus de la
pous-sière du chemin. Elle portait des jumelles au cou, s'arrêta à la
balustrade et se mit à regarder la mer.
La glace venait de fondre et les premières vagues écumeuses de l'année se
distinguaient au large. Le brin de paille resta si longtemps immobile que
j'oubliai bientôt sa présence.
Moi aussi je me croyais invisible. Mon manteau était de la même couleur que
la pierre de la statue et j'imaginais que je m'étais fondue dans ce groupe
aux vêtements frémissants et aux cris muets.
Mais le brin de paille s'était retourné pour examiner la sculpture.
"Qu'en pensez-vous?" dit-elle.
"C'est à moi que vous parlez?" demandai-je, effarouchée.
"Il n'y a personne d'autre ici," dit-elle tranquillement. "Vous croyez
qu'on va les sauver?"
"Les Naufragés? Je ne me le suis jamais demandé. Une statue n'est pas une
histoire," fis-je d'un ton entendu.
"Non, c'est vrai," admit-elle. "Mais ce cri - je l'ai entendu ailleurs dans
cette ville. Et alors on commence à s'interroger à s'interroger soi-même
avant tout."
"Et vous trouvez des réponses?" demandai-je.
"Je réponds rarement," dit-elle. "Mais ce n'est pas nécessaire: la vie s'en
charge. C'est généralement une réponse longue et circonstanciée."
Je l'examinai plus attentivement. Elle avait un visage de montagnarde:
étroit, clair, sans peur. Son regard vif et d'une profonde clarté venait du
cur de l'ombre. Elle était vêtue comme une ascète, à la chinoise: veste
sombre de style militaire et longs pantalons.
"C'est donc ainsi que vous faites," dis-je, déjà un brin intéressée. "Vous
vous interrogez sur toutes choses?"
"Mais oui," dit-elle, en me regardant de très loin.
"Et la vie vous répond?" poursuivis-je d'un ton où perçait un soupçon de
moquerie.
Elle me jeta alors un regard si pénétrant que je l'aurais jugé impudent
s'il n'avait été aussi sereinement impassible.
Elle plongea ses yeux dans mon inexistence, là où il y a comme une pi-qûre
d'épingle, mais si profonde qu'on aurait beau y jeter tout ce que l'on
possède - tous ses souvenirs, ses doutes, ses exigences et ses
subterfuges, bref, toute sa vie - , on n'y trouverait toujours rien.
"Une question m'a longtemps tourmentée," dit-elle. "Durant de nombreuses
années. Et puis un beau jour je me suis rappelé que je l'avais oubliée.
Elle était par-tie, et c'est ainsi que je sus que j'avais obtenu une
réponse."
Ses paroles et le ton qu'elle employait m'embrouillèrent. Je me retournai
pour regarder les Naufragés.
"Je crois bien qu'ils se noient."
"Vous avez peut-être raison. Ils se noient si personne ne les entend."
Puis elle reprit, le regard vers la mer: "Il fut un temps où je voulais
être quelque chose pour les autres, quelque chose qui serait comme comme
un brin de paille."
Cela m'amusa presque. Elle en était manifestement un, en effet.
"Et vous venez souvent ici?" demandai-je.
"Tous les mardis et les jeudis."
"Tous?"
"Tous," répéta-t-elle en tapotant ses jumelles. "Il me faut voir l'horizon."
Puis elle se retourna. Sans me saluer, sans plus prêter attention à moi,
elle se mit à descendre la pente entre les grands tilleuls. Certains des
arbres étaient si vieux qu'ils étaient couverts de fentes, de creux et de
plaies qu'on avait comblés avec du bitume et consolidés avec des boulons de
fer. Avant même d'en être consciente, je me retrouvai à sa hauteur devant
l'Échassier entre les pattes duquel clapotait une eau froide et
indifférente.
Elle s'arrêta sur les marches qui menaient à la rue en contrebas, ôta un
soulier dont elle fit tomber quelques grains de sable. Debout sur un pied,
son soulier à la main, elle restait là à méditer comme une grande et
vieille grue cendrée.
Je me tenais quelques marches plus haut, souriante, lorsqu'elle leva les
yeux: "Ah, vous êtes encore là."
Puis elle remit son soulier.
"Et moi, je suis ici."
Elle tapota l'escalier du pied. "Et là où quelqu'un se tient, personne
d'autre ne peut se mettre."
En raison de la conviction avec laquelle elle fut exprimée, cette phrase,
bien qu'une lapalissade, me troubla l'esprit, qui avait été si longtemps
muet et glacé. L'apparition avait recommencé sa descente des escaliers,
mais je ne la suivis plus.
"Va où tu veux," dis-je dans son dos. "Aussi loin et aussi longtemps que tu
le veux. Mais viendra un mardi ou un jeudi, beau ou gris"
J'étais restée la main sur la balustrade et je vis sa mince silhouette se
hâ-ter dans la rue au loin. Je regardai mes chaussures et vis en-dessous
les marches de granite, la pierre rose et les cristaux qui y miroitaient,
plus vi-vants, plus réels que bien de longues années.
LÀ OÙ VOUS ÊTES
Ne fut-ce pas la pierre que je vis avant toute chose dans cette ville?
Elle était partout, taillée ou lisse, rêche ou polie. Elle revêtait le sol
des places et bordait les trottoirs étroits. Elle formait les fondations
des maisons, les escaliers, les socles des statues et les monuments
grandiloquents à la mémoire des grands hommes.
Elle dépassait du sous-sol et de la mince couche de terre comme un front
ridé par des pensées graves, dans les squares, les arrière-cours et les
terrains vagues. Même les routes qui menaient à la ville avaient été
tracées ou mi-nées dans ce matériau. Elle formait le socle et la matière
première de cette contrée, c'était le sceau et le destin de la ville comme
le sont le sable à Rotterdam, le limon à Venise ou les schistes bitumineux
à Pittsburgh
J'ai vu ici de petites rues tranquilles et des artères aussi fréquentées
que le fleuve des Enfers. Dans mes rêves, j'ai cultivé à ses abords des
choux dont les colonnes ininterrompues d'automobiles écrasaient toutes les
têtes rondes.
A un coin de rue, sous une grande horloge, se trouve un café qui sert de
l'herbe et des bouteilles d'alcool de contrebande. Une nuit, on y organisa
une importante réunion; je m'assis dans un coin pour y manger une soupe.
L'un des participants à la réunion, un jeune homme que je connaissais
vaguement, s'approcha de moi.
"Vous permettez?" fit-il en me prenant des mains ma cuiller, avec la-quelle
il pêcha quelque chose dans mon assiette; puis, tenant la cuiller loin
au-dessus de lui, il alla la montrer à sa tablée.
"Regardez," dit-il.
Un murmure d'incrédulité et de dédain remplit toute la salle. J'essayai de
tendre le cou pour apercevoir le contenu de la cuiller, mais le jeune homme
la tenait si haut que je ne voyais rien.
De là, je suis venue dans cette rue tranquille où se trouve une cour que
j'ai vue sur une image: une étroite arrière-cour et un musicien de rue, un
petit homme avec son violon. Les murs étaient percés de fenêtres, mais pas
une seule n'était ouverte. Dans le bord inférieur de l'image, une main
hési-tante avait tracé ces mots: 'Seul avec Dieu.'
'Vivre sous le regards des autres.' Espaces ouverts et fermés, libres et
fluides. Rues, chambres et cours. Escaliers, places et clochers. Temples.
Marchés. Ponts et pas, blancs navires. Visages flottant dans les rues comme
des pétales détachés.
Lorsque les réverbères s'allument, la pierre perd sa lourdeur. Un profond
éclat embrase la patine des briques et du gypse. Dans les parcs, les arbres
sont la silhouette du soir.
'Notez le charme et la douceur qu'on rencontre dans les rues sur le vi-sage
des hommes et des femmes lorsqu'approche le soir et le mauvais temps'
Amoncellement de matériaux, chaos mécanique, petite Babel: ainsi était la
ville à la lumière du jour.
Mais non, à présent c'est autre chose: là où vous êtes C'est une
conscience, une vaste figure autonome, c'est le véhicule qui emporte
l'héri-tage du jour et de la nuit à travers des zones interminables.
L'ÉCLAT DU VERRE
Partout dans la ville, sur les marchés et les places ou au coin des rues
s'élèvent de petites tours. C'est un bonheur de les regarder, elle plaisent
à mes yeux errants.
Si l'on me demandait de les décrire, je dirais qu'elles sont vertes. Il est
vrai que si c'est le même vert que celui des tramways et des poubelles dans
les parcs, leurs murs sont surtout constitués de panneaux de verre. Elles
sont visibles de loin car il y brille toujours une lumière; leurs portes
n'ont pas de verrou mais une simple poignée, de sorte que n'importe qui
peut y entrer à tout moment.
J'ai vu des files de gens devant ces tours le soir à l'heure de la
fermeture des bureaux. J'en ai vu qui entraient seuls, l'argent à la main,
tandis que la lourde porte se refermait automatiquement derrière eux. Ces
tours sont bien exiguës pour deux personnes, et pourtant elles ont été
conçues comme lieux de ren-contre, pour la conversation.
Mais une fureur anonyme se concentre sur ces étroites chambres de verre.
Des fissures en constellent les parois transparentes, et mainte fois j'ai
dû en revenir bredouille, sans avoir établi de contact.
À mes yeux, cependant, ces tours sont aussi belles que des pagodes
chinoises. La plus grande visibilité s'y associe à une extrême intimité. Au
crépuscule, n'importe qui peut observer le visiteur de l'extérieur. Je le
vois claire-ment à travers la vitre comme dans une lumière sous-marine. Je
vois le doigt qui sélectionne sur un disque un morceau après l'autre,
choisissant ainsi son propre parcours.
Le profil de son visage est immobile; il réside dans sa paix comme une
statue. Il règne à l'intérieur le même calme qu'entre deux rapides.
Mais celui qui a pénétré dans la tour a pu aller plus loin encore. Certes
je peux l'y voir, mais lui-même est déjà ailleurs, à l'endroit d'où il
transmet sa voix. Je vois ses lèvres qui s'ouvrent, et dans l'impatience de
mon at-tente, je suis jalouse de le savoir déjà arrivé.
Ces petites tours vertes sont les phares nocturnes de la ville. Dans leur
isole-ment limpide, dans leur solitude transparente, elles témoignent de la
réalité du contact.
Lorsque j'étais malade, j'ai vu dans mon sommeil une telle petite mai-son
de verre, elle et rien d'autre. Rien ne bougeait dans mon rêve; mon sommeil
lui-même était une cellule vide et verte qui résonnait, qui m'invi-tait
sans relâche en retentissant comme si elle sonnait dans un vaste lieu: un
hall de gare la nuit ou bien la profondeur du passé.
Mais personne ne répondait car, bien que ce rêve fût mien, je n'y étais pas.
DOÑA QUICHOTTE
Chaque fois que quelqu'un lâche cette piteuse expression: 'c'est la vie',
en ho-chant la tête d'un air apitoyé, je pense à Doña Quichotte. Je revois
son mince poing blême frapper la table à en faire danser le cendrier, et
j'en-tends son refus pas-sionné exprimé avec force: "Non! La vie n'est pas
comme ça! Elle ne sera jamais comme ça, à moins que vous, vous ne la
ren-diez ainsi"
Comme elle est grande et mince! Il me semble parfois qu'elle n'a jamais
cessé de grandir, non pas à la manière d'un enfant, mais comme si un
contrepoids à la force de gravité tentait sans relâche de l'arracher à la
terre.
Je ne manque jamais d'être bouleversée à la vue de ses chevilles et de ses
poi-gnets, stupéfaite à la vue de ses pieds. Comment peut-elle tenir debout
et se mouvoir sur des chevilles si fines, des pieds si étroits?
Un soir, je l'aperçois de dos alors qu'elle se tient à la fenêtre et cela
me fait tres-saillir car j'ai l'impression qu'il y a un arbre dans la
pièce.
Doña Quichotte elle-même dit qu'elle n'est pas humaine, et j'incline à la
croire. Mais il se pourrait aussi que ce soit exactement le contraire et
qu'elle soit tellement plus humaine que la majorité des gens que c'est pour
cela précisément qu'elle apparaît si singulière.
Mais Doña Quichotte n'est pas un chevalier à la triste figure. Quand je
pense à elle ainsi, de loin, je la vois comme une flamme, et l'envie me
prend de tendre le doigt pour m'y réchauffer.
Je ne suis pas la seule à avoir cette aspiration. Souvent, le soir, les
frileux viennent remplir sa petite chambre. Ils arrivent séparément et se
regardent de travers, chacun jugeant les autres comme autant d'importuns.
Vraiment, je n'ai jamais côtoyé autant de malheur que chez Doña Quichotte.
Leurs peines sont diverses, mais tous sont seuls et tous estiment qu'ils
sont tom-bés de l'arbre de vie. L'écho de leurs plaintes se multiplie en se
heurtant aux obs-tacles que sont les autres.
Seule Doña Quichotte n'est pas touchée. Elle laisse le malheur la
traver-ser puis s'abîmer dans la vallée ombreuse du silence, afin que les
autres parviennent à oublier.
Mais les hôtes de Doña Quichotte changent fréquemment. Cette année, on n'y
voit pas les mêmes visages que l'an dernier. Où disparaissent-ils tous?
Il arrive qu'ils croisent Doña Quichotte par hasard dans la rue sans même
la reconnaître. J'ai vu Doña Quichotte les saluer, agripper même la manche
de leur veste, mais ils la regardent d'un air si décontenancé qu'elle en
reste toute pe-naude et les laisse repartir.
"Pourquoi t'oublient-ils si vite?" lui demandé-je d'un ton désolé.
Elle réfléchit. Son regard couleur de lilas est extraordinairement lointain.
"S'ils se souvenaient de moi, ils se souviendraient de leur malheur," dit-elle.
LE CORTÈGE
Enfant, Doña Quichotte entra un jour dans la chambre à coucher de ses
parents alors qu'il n'y avait personne dans la pièce et que le reste de la
fa-mille écoutait la radio au salon.
Doña Quichotte s'approcha de la coiffeuse de sa mère pour s'y mirer. Mais
lorsqu'elle regarda dans le miroir, elle n'y vit pas son reflet. D'autres
gens s'y trouvaient, de parfaits inconnus, dont beaucoup portaient des
vêtements qu'elle n'avait jamais vu personne porter: longues pèlerines,
larges cols blancs, couvre-chefs aux formes étranges.
Elle regarda et regarda encore tandis que les gens du miroir, hommes,
femmes et enfants, allaient et venaient en cortège ininterrompu.
"Cela ne finira-t-il jamais?" se demandait la petite Doña Quichotte de-vant
le miroir. Elle était lasse et aurait bien voulu voir son propre reflet,
mais le flot des in-connus dans le miroir ne tarissait pas.
Elle les voyait comme par une fenêtre, ignorant pourtant si eux la
voyaient. Elle demanda enfin: "Quand viendra mon tour?"
"Ton tour est-il jamais venu?" dis-je à Doña Quichotte qui, dans la lueur
de la lampe de chevet, a l'air d'une très vieille Indienne.
"C'était mon tour," dit-elle. "C'est cela précisément, mon tour, mais il
s'en est passé du temps avant que je ne le comprenne."
UTA ET ECKHART
Uta vivait jadis dans une autre ville. Voici sept siècles à présent qu'elle
se trouve dans le chur de la cathédrale.
Enfant, je reçus de Naumburg une carte postale représentant Uta. J'épinglai
la carte au mur du vestibule, de sorte que je croisais son délicat vi-sage
de pierre chaque fois que j'entrais ou sortais.
Plus tard, j'ai vu d'autres images d'Uta. Dans certaines elle est seule,
alors que dans d'autres son époux Eckhart se tient à son côté. Entre les
deux, me semble-t-il, s'interpose un silence profond et immuable.
La figure d'Uta enveloppée dans un manteau est à la fois hautaine et
ré-servée. Elle tient son ample manteau serré sous son menton de sorte que
le col vient presque couvrir la bouche. C'est pour cela que je regarde
cette bouche comme à la dérobée. Comme s'il y avait là une douleur
déshonorante ou une partie du corps trop intime. C'est une blessure
délicate, insolente, magnifique, qui dit obs-tinément non.
La main droite est invisible sous le manteau. Les doigts fins et légèrement
écar-tés de la main gauche, au contraire, sont visibles. Son index s'orne
d'une grande bague ronde vraisemblablement offerte par Eckhart. Elle porte
encore un autre bi-jou, dans une mise sobre par ailleurs: une agrafe fixée
à l'épaule gauche de son manteau, presque identique à celle qui se trouve
sur la large poitrine d'Eckhart.
On ne voit pas sa chevelure, dissimulée qu'elle est par une coiffure en
forme de heaume surmontée par une petite couronne.
Son regard est perdu dans le lointain, ses paupières sont très légèrement
plis-sées, comme si ce qu'elle voyait ne lui plaisait guère. Oui, c'est
bien cela: un léger dédain avive son regard, si bien couvert par la douceur
et la bien-séance qu'il est à peine identifiable.
Uta et Eckhart. Fondateurs de la cathédrale de Naumburg, dignitaires de la
cité. Le maître anonyme qui façonna Uta et Eckhart ne les avait jamais
rencontrés. Lorsque leurs portraits furent achevés, ils reposaient dans
leur sépulcre depuis des décennies déjà, sous ce gratte-ciel qui ne fut pas
érigé se-lon les normes d'ici-bas.
Tout ici se dresse au ciel comme dans une forêt. Mais les roses qui
étincel-lent dans les vitraux montent plus haut que la couronne des arbres.
Point de parois ici, rien que du verre, des piliers et des supports - que
des échafau-dages de planches et de lattes, mince ligne qui s'élève d'un
octave à l'autre.
Non, il ne s'agit pas d'un bâtiment, mais bien d'une route dressée, d'un
délire tramé dans la pierre, du rêve mégalomane d'une araignée.
Peu de matière, davantage d'espérance. Et plus haut s'élancent les flèches
des tours, plus elles éloignent l'invisible.
A leur base, au milieu des colonnes dressées, pierre parmi les pierres se
tient Uta. Son regard qui élude, le col relevé pour protéger son visage, sa
bouche sur le point de tressaillir depuis sept cents ans Qui sait si elle
ne souhaite pas s'en al-ler d'ici, se retirer dans l'ombre, s'effriter, se
désagréger?
Uta de la cathédrale de Naumburg. Existe-t-il ailleurs une autre statue
qui, dans son immobilité de pierre, puisse témoigner aussi irréfutablement
de la chair orpheline et du frissonnement de l'esprit?
L'ENFANT CRO-MAGNON
Je ne parviens pas à le quitter des yeux, bien que je m'efforce de regarder
au-delà, vers le fourmillement des rues, des places et des parcs. Il ne me
re-marque pas, mais moi je le reflète comme une surface luisante.
Il monte toujours dans le bus au même arrêt, près de l'école pour les
sourds. Il a sur la tête un bonnet rayé comme en portent tous les en-fants,
mais son front semble avoir été façonné par un forgeron idiot du vil-lage:
là où, chez d'autres, il se creuse en direction de la racine du nez, chez
lui il jaillit brusque-ment et de travers avant de s'interrompre tout net
juste au-dessus des sourcils. On dirait un abri contre la pluie qu'il doit
avoir constamment devant les yeux.
Un garçon plus petit l'accompagne; ils se trouvent une place as-sise car le
bus est à moitié vide à cette heure matinale.
Leur langage par signes me fascine: doigts tendus, noueux, comme dé-formés
par un rhumatisme articulaire. Mains de vieux gnomes, belles pour-tant et
inten-sément sensibles.
Que disent-ils? Je ne comprends rien, pas un traître mot, mais j'aimerais
sa-voir: ce doit être important. Le petit garçon assis de biais en face de
moi en-tend et comprend tout. Ils gesticulent, hochent la tête et rient, et
le plus petit se frappe même les genoux. Ils ne voient pas les autres
passagers.
En suivant des yeux ces mains sémaphores, je me souviens d'une dan-seuse
indienne venue donner une représentation en ville il y a des années.
J'étais triste en me rendant à la représentation, triste aussi lorsqu'elle
se termina.
Mais entre deux, regardant son corps vivre comme si ç'avait été non pas un
corps humain mais la corolle d'une fleur, une grande flamme, un fais-ceau
de lumière, un animal délicat ou quelque chose que la matière est cen-sée
être mais qu'elle trahit et oublie sans cesse - entre deux, tandis que le
sari éclatant voletait et que chevilles et poignets se redressaient,
s'éle-vaient - je vis distinc-tement que la vie, que le bonheur
Et à présent que ce nain de pantomime en face de moi parle volubilement et
sans bruit dans sa langue inconnue, je crois voir encore
Je vois et puis j'oublie. Je vois et j'oublie.
LA TOUR
Au cours d'une promenade dominicale, Doña Quichotte et moi nous
re-trou-vâmes dans un parc au milieu duquel s'élevait une vieille tour
crénelée dont les briques rouges irradiaient une chaleur sèche et riche
comme une terre d'arrière-été.
Derrière la tour, le parc était coupé par une large route bétonnée
au-des-sous de laquelle courait un tunnel routier, mais, au-delà, de grands
érables s'élevaient sur une pente. Leur couleur était précisément en train
de changer, le vert commençant sa longue retraite.
"Viens, asseyons-nous à l'ombre," dit Doña Quichotte. "Nous pourrons voir
l'étang."
Celui-ci n'était qu'un il glaucomeux, fangeux, eutrophié. Une légère brise
en montait comme d'un vin éventé.
"Un meurtre a été commis jadis dans ce parc," fit Doña Quichotte. "Je l'ai
lu il y a bien longtemps dans un journal."
"Qui a été assassiné?" demandai-je tout en m'éventant avec une feuille d'érable.
"Une jeune fille," dit Doña Quichotte. "Un garçon qu'elle n'avait jamais
ren-contré de sa vie la viola et l'étrangla. J'aurais sûrement bien vite
oublié l'inci-dent si une phrase ne m'avait frappée."
Comme elle restait silencieuse, je lui demandai quelle avait été cette phrase.
"Ne me frappe plus, je suis déjà morte," dit Doña Quichotte.
"Regarde, une libellule!" Je montrai du doigt la longue aiguille bleue qui
s'était posée sur la manche de Doña Quichotte.
Celle-ci observa l'insecte au repos. De la rue du port nous parvenait le
crisse-ment d'un tram; la libellule s'éleva verticalement, resta un instant
immobile soutenue par l'air, puis s'en fut.
Doña Quichotte se leva d'un bond. "Viens, faisons le tour de l'édifice."
C'était une tour octogonale de trois étages avec une seule porte
solide-ment verrouillée. Qui l'avait construite et dans quel but? Nous n'en
sa-vions rien. Mais elle faisait partie du paysage comme si elle y avait
poussé, comme si elle y avait ses racines. Sévère et élancée, Doña
Quichotte chemi-nait devant moi à grands pas décidés, semblable à la tour.
"On s'en va?" suggérai-je, mais elle ne parut pas m'entendre.
"Sais-tu ce qu'elle voulait dire?" dit Doña Quichotte en s'arrêtant.
"Qui?"
"La fille, quand elle a dit cela. Tu as déjà vu des enfants jouer à
cache-cache? Et tu as entendu ce que crie l'enfant caché à celui qui le
cherche: 'Je ne suis pas là!' À présent, le garçon tournera sans cesse
autour de la tour qui toujours découpera son paysage en deux."
"Mais ne crois-tu pas qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une
récon-cilia-tion? Ou sinon une réconciliation, du moins l'oubli - ou
peut-être la grâce?"
Mais plutôt que de répondre, Doña Quichotte tendit le doigt en direction de
la libellule qui à nouveau frémit sur son épaule, un éclat froid d'écailles
sur ses ailes.
LA MOMIE
Il m'a fallu longtemps pour atteindre cette ville où je ne suis encore
ja-mais venue et dont je ne parle presque pas la langue. Lorsque le train
entre en gare, c'est déjà le soir et mon sac me pèse. Je cherche des
porteurs sur le quai, mais à leur place un homme en uniforme s'approche et
me fait signe de le suivre. Comme j'hésite, il me montre une carte
indiquant qu'il est policier ou qu'il en a du moins les prérogatives.
Il m'emmène à la consigne et désigne ma valise. "Ouvrez-la,"
m'or-donne-t-il. Je m'exécute, puis il examine et retourne chaque article,
fouille à l'intérieur de mes chaussettes, secoue mes livres et ouvre
jusqu'à la petite boîte de chocolats.
"Pourquoi?" demandé-je, mais il ne répond pas. Ce n'est que lorsqu'il se
met à dévisser mon réveil de voyage que je réalise qu'il est à la recherche
d'une bombe, et je me souviens alors qu'un attentat a échoué tout
récem-ment dans une autre gare.
Bon, je ne porte donc pas de bombe. L'homme repousse brusquement la valise
vers moi sans même s'excuser. Mais ses soupçons infondés ont eu pour effet
que l'autocar que je devais prendre pour un village proche où habite une
fa-mille de ma connaissance est déjà parti. Le premier garni que je trouve
est com-plet, et dans le second j'apprends qu'il y a actuelle-ment une
grande foire dans la ville.
Je remonte une rue, en descend une autre, en traînant ma valise qui ne
contient pas de bombe et en examinant les enseignes des hôtels. Les rues
grouil-lent de monde mais je n'ai pas même l'espoir d'y apercevoir un
vi-sage connu. Dans une réception sombre et étriquée, on me tend enfin une
petite clé et on m'indique le prix, qui est exorbitant.
Lorsque j'ouvre la porte, je découvre que la chambre est déjà occupée:
quel-qu'un est couché dans l'autre lit, sous les draps, la tête tournée
contre le mur et paraissant profondément endormi. Ça ne me plaît pas du
tout; j'ai payé pour une chambre particulière et j'ai l'impression d'avoir
été dupée. Mais je suis fatiguée et je ne me sens pas la force de
redescendre et de me quereller dans une langue étrangère.
Du seuil, j'aperçois mon reflet dans une haute armoire à glace qui se
dresse contre le mur du fond, aussi insignifiant que n'importe quel passant
dans l'ani-mation des rues. Je me déshabille vite et sans bruit afin de ne
pas réveiller ma compagne de chambre.
Je reste longtemps couchée les yeux ouverts dans cette chambre qui
n'ap-par-tient à personne et dont les objets exhalent l'anonymat de toutes
les chambres de passage. J'ai de la peine à m'endormir en pensant à tous
les iti-néraires qui ont passé par ce recoin, de la peine à m'endormir
quand ma compagne de chambre est si parfaitement immobile et sa respiration
si faible que je ne dis-tingue qu'à peine la mienne dans les brefs moments
de silence absolu.
Je ne pense pas qu'elle dorme.
Quant à moi, c'est en me réveillant que je me rends compte que j'ai dormi.
On pleure comme si on pleurait depuis longtemps, depuis des heures,
hoquetant et pantelant. De puissants spasmes de chagrin se-couent le lit
sous la fenêtre.
J'écoute ces accès d'émotion les nerfs tendus, tout en me disant que je
de-vrais me lever et demander: "Que se passe-t-il?"
J'esquisse un geste, repoussant ma couverture, mais elle semble deviner mes
intentions et s'efforce de retenir ses plaintes. Je n'arrive pas à me
déci-der; je reste longtemps couchée ainsi, sans couverture, et je commence
à avoir froid. Les gé-missements un instant contenus reprennent de plus
belle, les soupirs enlèvent l'espace et l'oxygène de la pièce, et les
larmes de l'étrangère inondent ma vie comme une pluie amère.
Pleurs interminables! Chagrin infini qui jaillit en geyser glacé d'une
fis-sure de cette existence inconnue, si profonde qu'il paraît impossible
de trouver où que ce soit de quoi la combler, c'est une coulée de lave qui
atteint et fige tout mouve-ment. Le flux et le reflux des sanglots berce
mon lit et les pleurs se joignent à l'obscur réseau de mes souvenirs, que
je sens avec épouvante se mettre à gonfler.
Non, je ne veux pas me souvenir, me dis-je à moi-même. Mais à quoi bon? Ma
mémoire est cette momie enveloppée dans ses draps.
Et alors que je me débats dans le noir pour barrer la route au convoi
in-termi-nable des humiliations et des désillusions, du repentir et de la
honte, de l'amer-tume et des malentendus, des peurs et des pertes, ce qui
n'était tout à l'heure que le chagrin d'une compagne de chambre sans visage
s'élève comme la vague de Hokusai, et je perçois le grondement qui depuis
toujours retentit sans cesse autour de ma vie chiche, sèche et close.
MOZART NOUS A TROMPÉS!
Un homme désespéré arriva chez Doña Quichotte un jour de novembre,
ex-pliquant qu'une rage amère lui consumait les entrailles, assez pour
ré-duire la ville entière en cendres. Il ajouta qu'elle enfumait son
cerveau comme le phos-phore peut couver dans la chair encore vive.
"L'eau n'éteint pas le phosphore," voilà ce qu'il dit, "et aucun réconfort
ne saurait apaiser ma fureur."
Une couverture de disque se trouvait sur la table de Doña Quichotte. Tout
en parlant, l'homme la prit dans les mains et se mit à la tourner et à la
retourner de ses doigts fébriles. C'était La Flûte enchantée de Mozart.
"Wolfgang Amadeus Mozart!" fit-il d'une voix qui crépita comme une
fusil-lade. "Wolfgang Amadeus Mozart!" hurla-t-il encore une fois, comme un
huis-sier crie le nom de l'accusé qui doit comparaître devant le juge.
"C'est un menteur," dit-il. "Wolfgang Amadeus Mozart nous a trompés."
"Comment nous a-t-il trompés?" demanda Doña Quichotte d'une voix égale.
L'homme rit amèrement. "En nous faisant croire à ce qui n'existe pas.
Rappelez-vous seulement la limpidité de son quintette à cordes, le noble
idéal de fraternité de la Flûte enchantée, l'amour désintéressé de Tamino
ou la joie du glockenspiel Rien de tel n'existe dans le monde, et il
devait bien le savoir aussi."
"Mais il a également composé le Dies irae et l'Ave verum corpus," fit Doña
Quichotte avec bienveillance.
"Bien sûr," admit l'homme, "ils sont à lui et ils sont à tous. Mais le
reste n'est que douce supercherie, le tintement creux d'un glockenspiel."
La table trembla et l'homme eut un mouvement de recul. Doña Quichotte, qui
l'avait heurtée de son poing frêle, le regardait avec des yeux enflammés.
"Croyez-vous donc," dit-elle d'une voix profonde et maestoso, "croyez-vous
donc vraiment qu'il ne sut pas voir au-delà des jours de courroux,
vertigineuse-ment loin, aussi loin qu'ici et plus loin encore? Vous ne
tenez pas à survivre, vous. Combien de temps Mozart, lui, a-t-il survécu?"
L'homme resta longtemps assis en silence. Il semblait s'être apaisé et se
mit bientôt à parler de tout autre chose.
Au moment de son départ, après que nous nous fûmes souhaité bonne nuit, il
s'attarda encore un peu sur le seuil. J'eus l'impression qu'il était sur le
point de dire quelque chose d'important, mais il se contenta finalement de
faire remar-quer: "Le temps semble se calmer," puis il se coiffa de sa
cas-quette et s'en fut.
"La vengeance brûle à présent dans ma poitrine," murmura Doña Quichotte
lorsqu'il fut parti. "Sais-tu de qui il s'agissait? C'était le Maure,
Monostatos."
Puis elle se mit à fredonner: "Das klinget so herrlich, das klinget so schön"
LA CHAMBRE DU TEMPS
Tic-tac.
Certaines montres faisaient vraiment cela. Mais la plupart étaient
silen-cieuses: elles étaient pourvues d'une pile qui les maintenait à
l'heure une année, deux ans ou même huit.
Nous nous étions rendues chez un horloger car le bracelet de la montre de
Doña Quichotte s'était cassé. La boutique était toute petite et très
éton-nante, contenant davantage d'objets hideux que je n'en avais ja-mais
vu en une seule fois.
Des coupes couleur de bronze étaient alignées par ordre de grandeur le long
de l'étagère supérieure; on aurait dit des femmes enserrées dans leurs
corsets.
"Si je prenais part à une compétition," me dis-je, "et que je découvrais
par avance de telles récompenses, je choisirais de perdre."
Les murs étaient couverts de montres de poche aux chaînes de plastique
bril-lant décorées de torsades couleur turquoise et rouge aniline. Il y
avait aussi des cendriers en forme de bottes d'équitation, de bouche ou de
cuvette de WC. Mais chaque objet était recouvert d'une mince couche de
poussière graisseuse comme si aucun client n'était entré ici depuis des
semaines.
"Bonjour," fait Doña Quichotte.
" 'Jour," répond l'horloger pansu aux yeux injectés de sang en se
soule-vant derrière le comptoir; l'homme est aussi curieux que les objets
dont il est en-touré.
Il présente à Doña Quichotte des bracelets de montre et des cadres pour
photos recouverts de poudre d'or. Ils ne font aucun effet sur elle.
Elle regarde les montres digitales qui reposent sous une vitre.
"Elles n'ont pas de visage. Elles n'indiquent pas l'heure, elles montrent
l'ins-tant. Il n'y a ni jour ni nuit avec elles, il n'y a pas de passé,
ont-elles même un avenir?"
L'horloger rumine une réponse tandis que je déplace mon poids d'un pied sur
l'autre en observant une plaque en bois de genévrier où il est écrit en
pyrogra-vure: 'On ne tient pas sa maison dans les nuages ou dans le vent.'
"Je crois que les gens s'en sont déjà lassés," fait l'horloger. "Ils
n'achètent plus de montres digitales avec le même enthousiasme
qu'auparavant."
"Qu'est-ce au juste que le temps?" dit Doña Quichotte?
"Comment?" fait l'horloger.
"Le temps est une substance," explique Doña Quichotte. "Oui, une sub-stance
élastique. Comme de la cire."
"Oh"
"Si on le désire vraiment," continue-t-elle, "on peut apprendre à la
mo-deler. A l'étirer comme un chewing gum. Puis à en former une jolie
petite boule et à la lancer au loin, mais en réalité c'est un boomerang qui
vous revient."
Et Doña Quichotte se penche par-dessus le comptoir avec ses innom-brables
montres comme si c'était elle, en réalité, qui était chargée de les vendre.
"J'étais ici l'été dernier lorsque la ville s'est arrêtée. Les fumées
restaient sus-pendues au-dessus des toits. Un cycliste pédalait et pédalait
dans la rue sans parvenir nulle part. Les feux de signalisation restaient
bloqués au rouge et les cloches de l'église Saint-Jean ne faisaient plus
que 'dong, dong, dong'"
"Donnez-moi celui-ci," fait-elle ensuite en désignant l'un des bracelets.
L'horloger se hâte de le passer au poignet de Doña Quichotte, fin comme une
allumette, avant de s'éclipser un instant dans son arrière-boutique pour y
percer un trou supplémentaire. Il est excessivement prévenant et
s'em-presse de nous ouvrir la porte, non sans fourrer sa carte de visite
dans la main de Doña Quichotte sur le seuil.
Sur le chemin du retour, Doña Quichotte reste silencieuse, l'air préoc-cupé.
"Ai-je l'air vieille?" me demande-t-elle soudain.
Je me hâte de la rassurer.
"Tu mens," dit-elle d'un ton cruel. "J'ai regardé dans la vitrine et je m'y
suis vue. J'ai l'air vieille."
"De quelle vitrine parles-tu donc?"
"Celle de l'horloger. J'ai vu ma tête au milieu de tous ces objets
horribles: elle était très vieille."
Je ne dis plus rien; de tout façon elle ne m'écouterait pas. Elle s'arrête
au beau milieu du trottoir et son visage est nu et las.
"Le temps est un tigre," dit-elle. "Il n'a aucune morale. Aucune!"
Puis elle repart à si grandes enjambées que je parviens à peine à rester
sur ses talons. Au carrefour où nous devons nous séparer, elle me sai-sit
le bras en souriant mystérieusement.
"Sais-tu sur quoi le temps n'a pas d'effet?"
Au fond de ses yeux flamboient des vallons où tombe le soir.
Je secoue la tête et elle me souffle: "Un clin d'oeil, tu ne crois pas?"
PATROCLE AUSSI EST MORT
Un jour de gel brillant et tintant, je croise l'Incurable chez Doña
Quichotte. La ville paraît prise dans du sucre glace; une poussière de
neige étincelante recouvre les murs et les branches des arbres.
L'Incurable, aussi pâle que si lui aussi était de neige, s'est installé
dans le fau-teuil inconfortable de Doña Quichotte.
Lui qui, dans le temps, venait souvent ici fait à présent de longs séjours
à l'hôpital et il lui devient chaque jour plus pénible de se déplacer. Il y
a sept ans, sa fille est morte dans un accident de la circulation, et peu
après sa femme l'a quitté.
Mais le voici maintenant assis devant la fenêtre chez Doña Quichotte tandis
que la lumière de février jette sur son front et son cou des raies d'ombre
bleue. Il est presque collé au radiateur, mais il semble émaner de lui un
froid contre lequel le radiateur reste impuissant.
Doña Quichotte et l'Incurable parlent d'oiseaux. Les oiseaux ont été le
grand amour de l'Incurable, mais cela fait des années qu'il n'a plus vu les
mi-grations de printemps et d'automne, dit-il
Doña Quichotte raconte qu'un soir où elle remontait sa rue, un hibou s'est
envolé du porche de la cour.
"Il volait très bas et sans bruit," dit Doña Quichotte. "Et lorsqu'il est
passé devant moi, il m'a regardée droit dans les yeux."
"Les hiboux peuvent nous hypnotiser," dit l'Incurable en hochant la tête.
Il regarda un instant le ciel haut en soupirant. "Le printemps est en train
de poindre. J'aimerais encore une fois voir le retour des oiseaux."
"Ils reviendront," dit Doña Quichotte.
L'Incurable se leva péniblement, alla chercher sa serviette dans le
vesti-bule et en tira un gros livre.
" 'Hélas, mon ami,' commença-t-il à lire, 'tu devras mourir toi aussi;
pourquoi te lamenter ainsi? Patrocle aussi est mort et il était bien
meilleur homme que toi. La mort et le sombre destin me menacent également.
Viendra une aube, ou un soir, ou un jour où quelqu'un brisera ma vie dans
le combat' "
Il lisait d'une voix faible mais animée, et les mots de cristal qu'il
jetait dans la pièce tintaient comme une journée de février.
Un jour d'avril, j'allai sonner chez Doña Quichotte. Du seuil aussitôt elle
me dit: "Patrocle est mort."
Nous allâmes nous promener le long du rivage. C'était un jour où tout se
bri-sait et fondait, s'épuisait et se dissipait, un de ces jours où
l'ancien semble disparaître sans que le nouveau ait encore pris sa place.
"J'ai lu dans le journal que les alouettes sont déjà de retour," fit Doña
Quichotte.
Je levai la tête, mais le ciel était bas et sans la moindre brèche, comme
une grande aile duveteuse.
"Entends-tu?" demanda Doña Quichotte, mais je n'entendais rien.
"Tout est ainsi ici-bas, de sorte que, quand quelqu'un meurt, un autre
puisse continuer à chanter"
LE CYPRÈS DU SOLEIL
Il y a dans cette ville un panorama que je contemple souvent et que les
saisons n'altèrent pas. Nul besoin de grimper au sommet d'une tour
d'ob-servation, d'al-ler jusqu'au rivage ou même de regarder par ma
fenêtre.
Ce panorama est ici dans ma chambre. Quiconque y pénètre ne peut manquer de
voir l'île et l'arbre toujours vert sur sa butte au centre de l'île.
Mon île est un pot en terre glaise où l'humus forme un tertre arrondi comme
un sein, et dont l'arbre est un bonsaï, un petit cyprès du soleil.
L'arbre est très vieux. Son tronc est courbé et tordu comme s'il avait
poussé au coeur de la tempête sur un récif éloigné en pleine mer. Mais il
n'en est rien; le vent du ciel infini n'a jamais secoué ses aiguilles, bien
qu'il ait déjà vécu une ou deux vies d'homme. Il a grandi sous la torture,
ses ra-cines dans une terre maigre, émondé, ligaturé, épincé.
Dans sa silhouette courbée se concentre l'esprit de toute la rose des vents.
Au-dessous de l'arbre, de petites tiges poussent dans l'ombre. Lorsque je
re-viens de la ville, je voudrais bien me jeter dans ces taillis bruns, sur
le dos, à l'ombre de l'arbre.
Je pourrais y rester jusqu'au soir à contempler, rien qu'à contempler le
vert ar-genté de ses aiguilles et l'écorce rugueuse de son tronc.
Et lorsque les soirées d'août, alors que l'été cède le pas à l'automne,
embra-sent le ciel de la ville, ce cyprès du soleil, contre le fond
rougeoyant, est aussi noir qu'un signe calligraphique tracé par un maître.
Si je pouvais - si je devais interpréter son message, je me contenterais de
ré-péter les paroles de Sonia Alexandrovna:
'Il ne t'a pas été donné de connaître le bonheur dans ta vie, mais attends
seu-lement - - - attends, Bientôt nous connaîtrons le repos Bientôt nous
connaîtrons le repos.'
L'AUTRE ET LA NUIT
Puis vinrent des nuits où l'un tombait de son lit comme si celui-ci,
re-bondissant, l'avait jeté sur le parquet d'un double nelson bien calculé.
Et juste avant le choc, un cri sourd sortait de sa gorge: "A l'aide!", le
genre de couinement qu'on imagine sortir de la bouche d'un paralytique dont
la lite-rie prendrait feu.
Alors l'autre se levait d'un bond de son lit en grommelant: "Ce n'était
qu'un rêve," tandis que le premier rampait jusqu'à sa couche en tournant le
dos comme une barrière.
Mais ce n'était pas un rêve. C'était leur vie commune qui se mourait et qui
criait avec la bouche de l'un ou de l'autre. Leur vie qui ne parvenait pas
à se dé-rober à leur implacabilité, à leur amour rance, à leurs regrets et
à leur désir de vengeance.
A présent, l'un dormait et l'autre veillait. Elle qui veillait avait
attendu tout au long de la soirée. Et l'autre certes était revenu, mais ce
qu'elle atten-dait n'était pas revenu et ne reviendrait jamais, si cela
avait même jamais existé. Et pourtant l'attente continuait, comme une soif
aussi asséchante qu'un sirocco.
Maintenant, dans le noir, s'était effacée l'expression qui était si
étrangère à son visage et qui pourtant aspirait à s'emparer de lui:
séductrice, sollicitant une grâce, sûre déjà de sa défaite, et donc
résignée, et donc profondément répugnante. La nuit l'avait arrachée de son
visage comme la pâte dont on fait le pain de la dis-corde et du mépris.
Son visage invisible et baigné de nuit reposait comme une fleur amère sur
la taie d'oreiller tachée, tourné vers les ténèbres du plafond. Son corps,
qui commençait déjà à délaisser les souvenirs et les sollicitations de
l'amour, était exclusivement sien; c'était un objet léger et superflu,
immobile et clai-rement détaché, dessiné sur le lit comme on représentait
jadis sur le cou-vercle de certains cercueils la forme de celui qui y
gisait.
Mais elle savait que de ce roseau pourrait enfin sourdre à présent une
voix, une voix qu'elle avait longtemps brûlé d'entendre, une voix qui
énonçait, avec une compassion chaleureuse, comme une grosse nounou, une
question douce et sombre, une réponse convaincante, ferme et joyeuse:
'Pourquoi ainsi? Il n'est pas nécessaire de vivre ainsi Ce qui est
infléchi, redresse-le. Ce qui est cor-rompu, jette-le. Ce qui est mort,
inhume-le.'
Elle entendait la respiration de l'autre et elle respirait comme le rêve de
l'autre; le même souffle pénétrait leurs narines et en sortait. Le même
souffle - et elle s'étonnait: Comment était-ce entré dans la chambre?
Elle n'avait plus soif et elle savait que l'attente était finie. Une vague
avait submergé leur chambre et était arrivée dans la nuit là où l'attente
fi-nissait.
Elle songea à se lever et aller vers l'autre, le réveiller et dire: "Il est
ici mainte-nant."
Mais elle ne se leva pas avant le matin.
LA CELLULE
A la fin de l'automne, lorsque le temps change, Doña Quichotte devient
ner-veuse. On dirait qu'elle se met à papilloter, et parfois son humeur
vire-volte comme une feuille qui tournoie dans le vent.
Aujourd'hui, elle déclare qu'elle doit quitter sa cellule. Sa 'cellule',
c'est ainsi qu'elle appelle son appartement, et le mot résonne dans sa
bouche comme un sé-pulcre.
"Où irais-tu?" demandé-je.
"Il est impossible de vivre ici," dit-elle sans répondre. "Les gens y ont
abandonné leur malheur. Ce n'est pas un appartement mais un dépotoir. Cette
cellule sent mauvais."
Elle sort alors le journal du dimanche de je ne sais où et se met à
consul-ter la rubrique des ventes d'appartements.
Plus tard, nous nous retrouvons dans un vestibule inconnu tandis qu'un
agent immobilier nous fourre des prospectus dans les mains. Nous exami-nons
le plan de l'appartement: une chambre, un coin cuisine, une salle de bain
et trois armoires incorporées.
La chambre est vide et nue. C'est une abstraction de chambre, un espace
quelconque, un cube rempli de vide.
Voici la porte, par laquelle on peut entrer et sortir. Voici la fenêtre,
par la-quelle on peut voir. Elle recueille la lumière du ciel hivernal pour
la disper-ser dans ce réceptacle inoccupé.
L'agent immobilier parle du revêtement de sol, du carreau de poêle, de la
res-pectabilité des autres résidents.
"Si tu habitais ici," fais-je à Doña Quichotte, "qu'est-ce qui changerait?"
Sans me répondre, elle ouvre une porte d'armoire. Je ne vois rien qu'une
penderie, et pourtant elle reste plantée devant à l'examiner un long
mo-ment.
"Si tu déménageais ici," dis-je à nouveau, "crois-tu que tes souvenirs ne
t'y suivraient pas?"
Elle continue d'examiner l'armoire sans que je puisse deviner ses pen-sées.
"Et si la mélancolie te submergeait ici"
"Tais-toi!" fait-elle en refermant violemment la porte de l'armoire. Puis,
d'un ton enjoué: "Viens!"
Elle longe le trottoir en sifflotant. Je cours derrière elle tandis que
nous re-mon-tons une rue, en descendons une autre, à gauche, à droite, à
gauche et encore quelques pas. La neige fondue rejaillit sous nos pieds,
les devantures de magasins sont bordées de guirlandes d'épicéa. Le vent
nous transperce, nous et la ville, et le regard de Doña Quichotte est fixé
sur un point éloigné.
"Tu connais ça?" demande-t-elle.
Elle siffle quelque chose comme une menue question adressée au brouil-lard
qui entoure les réverbères.
"Qu'est-ce que c'est?"
"Pong pongtouli, pong pongtouli," fredonne-t-elle en sortant une clé de sa
poche.
J'examine la touffe d'herbe qui s'est balancée tout l'été, fixée dans une
fis-sure du perron devant la porte de Doña Quichotte. Ce ne sont plus que
quelques brins d'herbe jaunis, mais il me semble pourtant que ce sont eux
qui ont fendu la pierre.
Lorsque nous sommes revenues à la Cellule, Doña Quichotte enfile une sorte
de robe de chanvre aux coudes élimés et se prépare une tisane. Elle prétend
que ça lui éclaircit la vue.
Non, ça ne sent pas le malheur ici, rien que le tabac et la poussière des
livres. Des galets et une coupe de Samos trônent sur le rebord de la
fenêtre. Si l'on rem-plit la coupe à ras bord, le liquide s'écoule jusqu'à
la dernière goutte. Je la tourne souvent dans mes mains en pensée.
"Rien n'est jamais assez pour l'homme," me dit un jour Doña Quichotte
lorsque je lui demandai ce que signifiait cette coupe d'argile.
"Il demande toujours et encore plus. Et alors - houp-là - il perd ce qu'il
avait déjà."
Telle est la leçon de la coupe de modération.
LE SOUVENIR DE NOS GESTES
Un soir d'hiver, j'étais assise chez Doña Quichotte à lire le journal.
Sentant son regard sur moi, je levai la tête.
"Dis-moi qui tu es," dit-elle lentement.
C'était une question bien contrariante, et j'aurais préféré qu'elle ne
l'eût pas posée.
"J'y ai pensé," dis-je, "mais c'est quelque chose que je ne parviens pas à
éclair-cir. Tout ce que je sais est que si je regarde quelque chose assez
long-temps, n'im-porte quoi, je commence à lui ressembler comme à une
soeur. Et je sais ce que j'au-rais voulu être."
"Quoi?" demanda Doña Quichotte.
"Une paire d'yeux bleus, rien que ça et rien de plus," dis-je. "J'aurais
toujours voulu être non pas sur la scène mais dans la salle, là où tout est
sombre et silencieux et où il ne se passe jamais rien. Seuls les yeux
bougent mais j'ai fini par comprendre que personne n'a le droit d'y
rester, personne."
"Parce que la salle n'existe pas," fit Doña Quichotte. "Parce que la terre
baigne sous les projecteurs du soleil et de la lune. Et que chacun se doit
d'être Hamlet, c'est cela que tu veux dire?"
"Le souvenir de nos gestes" 'A notre réveil, seul le souvenir de nos
gestes demeure.' Cette phrase me revint alors à l'esprit.
"Ce n'est pas une bonne phrase," dit Doña Quichotte.
"Je ne sais pas," dis-je. "mais c'est la phrase de ma vie."
"C'est parce que tu vis à l'intérieur de ta tête," dit Doña Quichotte.
"C'est la phrase de ceux qui vivent à l'intérieur de leur tête."
Elle me cogna doucement la tête, à la naissance des cheveux, d'un doigt
frais et délicat.
"Hé, sors de là!" ordonna-t-elle.
"Pour aller où?" demandai-je.
"Ah bon," dit Doña Quichotte en se rasseyant, satisfaite. "Tu comprends
tout de même."
"Qu'est-ce que je comprends?" fis-je, étonnée.
"Que tu es déjà dehors. Dans le vaste monde. Les gens parfois l'oublient.
Et il ne reste alors plus qu'eux et le souvenir de leurs gestes."
L'ENFANT-MIROIR
J'ignore pourquoi Doña Quichotte l'appelle l'Enfant-Miroir. Je lui ai posé
la question un jour, mais elle ne m'a pas répondu.
Tout change très vite dans le miroir de son visage. C'est un petit visage
qui luit comme un foyer, aussi empli d'yeux qu'un archange.
L'enfant ne cesse de grandir, même dans son sommeil.
"N'as-tu pas bientôt fini?" lui dis-je souvent. "Je crois que c'est
exacte-ment la bonne taille. La taille idéale."
Mais il n'a pas fini.
Parfois, je le saisis dans mes bras et presse mon oreille contre sa
poitrine. Vais-je entendre autre chose que les légers battements de son
coeur? Un bruit de crois-sance, ce chant qui a frémi un jour dans chaque
corps, comme le murmure inces-sant d'une cascade ou le rayonnement
invisible qui en-toure tout ce qui pousse.
"Trilzadam qwalamba. Weedoo! Sorozzo!"
"Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est donc que ça?" demandé-je, et il
vient se mettre droit devant moi en répétant: "Tril-za-dam qwa-lam-ba.
Wee-doo! So-roz-zo!"
Je n'y comprends toujours rien et il éclate de rire.
Un jour, je me suis mis en tête de l'instruire. J'ai dit: "Les gens
naissent et grandissent, vieillissent et meurent."
Dans quelle colère il s'est mis! Il s'est écrié en frappant du pied: "Ce
n'est pas comme ça! Ce n'est pas comme ça!"
"C'est comment, alors?" ai-je fait, étonnée.
"Personne ne meurt jamais," a-t-il dit en me considérant avec condes-cendance.
Au printemps, nous avons joué au cerf-volant sur les rochers du rivage.
Hélas, le cerf-volant lui a échappé des mains et le vent l'a entraîné vers
le large. C'était un épervier noir et bleu, et les vagues froides se sont
disputé ses ailes.
L'enfant n'a pas pleuré.
Maintenant la première neige est tombée et la ville réverbère la lointaine
clarté hivernale.
Le grand bâtiment de pierre est vide. Tout le monde est parti, au travail,
en courses, en voyage ou à la mort, je ne sais.
Seul l'Enfant-Miroir joue dans l'abîme de la cour, dans l'ombre de la
neige. De ma fenêtre, je vois les flocons tomber sur son bonnet bigarré,
sur les marches qui conduisent à la cave et sur le tas de sable gelé. Avec
quelle humilité incommensurable se posent-ils sur la brique et le métal, le
bois et le verre, le bé-ton et les mains des hommes.
Quand je crie son nom, il lève la tête, puis se baisse pour ramasser un peu
de neige. Il a les doigts nus.
"Attrape!"
Il la lance vers la fenêtre éclairée. L'âpre substance de l'éternité et la
cha-leur diaphane de ses doigts.
Il s'étend parfois à mon côté et je le crois alors endormi. Mais il a les
yeux ou-verts, et il me regarde comme on regarde par une fenêtre.
"Lorsque je m'endors," dit-il plus tard, "ou lorsque je m'éveille, toutes
les couleurs se rassemblent ici."
"D'où viennent-elles?" lui demandé-je, et son doigt désigne le mur blanc où
une porte entrouverte dessine un brillant pilier.
Qu'est-ce qui pourrait tempérer, qu'est-ce qui pourrait bien atténuer
l'iné-lucta-bilité du hasard qui l'a fait naître sur cette terre.
LA LAMPE DE L'AQUARIUM
J'ai vu une petite maison dans un quartier oublié de la ville. Je l'appelle
la Maison Gothique car les pans de sa toiture sont si raides et
l'étroitesse de ses façades la fait apparaître si haute qu'on dirait une
cathédrale en miniature.
Je n'ai jamais vu les gens qui y habitent, mais il m'est arrivé d'y entrer
un jour. J'ai dû m'y rendre à cause d'un aquarium, parce qu'un ami qui
connaît l'un des locataires lui avait promis de prendre soin de ses
poissons pendant son ab-sence. Un dimanche de mai, il m'a appelée pour me
proposer d'y aller avec lui. J'ai accepté, car je serais allée n'im-porte
où avec lui.
"Nous y voici," fit mon ami en poussant une porte délabrée. C'était déjà le
soir et une lumière oblique recourbait les hautes herbes de la cour.
Nous pénétrâmes dans une grande pièce fraîche.
"Attends un instant," fit mon ami en disparaissant quelque part.
Je me surpris à examiner une image accrochée au mur qui me paraissait
singu-lière. Quelqu'un était étendu, les yeux fermés, au milieu d'un grand
pré. Il se trouvait à l'intérieur d'une tente basse et transparente,
peut-être une sorte de moustiquaire en étoffe de gaze. Le dormeur de
l'image baignait dans la pénombre d'une nuit d'été; il était étendu sur le
dos, les bras le long de son corps comme un défunt. Mais il n'était pas
mort car la gaze, la pièce, la nuit d'été tout entière on-doyaient avec le
souffle de son sommeil.
L'aquarium se trouvait dans le coin le plus sombre de la pièce. Je ne le
remar-quai que lorsque mon ami fut revenu et eut enclenché la lampe fixée à
l'intérieur du couvercle. Je promenai mon regard dans la brillante petite
pièce remplie d'eau.
"Que vas-tu leur donner?" m'enquis-je.
"Mmm." Il examina l'étiquette collée sur la boîte d'aliments pour
pois-sons. "Ce sont des termites lyophilisés."
J'ouvris la boîte et reniflai; l'intérieur était rempli de petites miettes
sombres et inodores. J'étais alerte et insouciante. Tout m'apparais-sait en
gros plan et remarquablement détaillé.
Les poissons s'étaient approchés de la surface dès que la lumière eut été
al-lumée. Je versai les miettes dans l'eau et les bouches rondes les
happèrent promptement. L'un des poissons était particulièrement grand,
vorace et magni-fique.
"Qu'est-ce que c'est?" demandai-je.
"Tu ne reconnais pas un poisson rouge ordinaire?"
"Ordinaire?"
Rien ce soir-là n'était ordinaire. Avec quelle grâce la créature se
déplaçait, avec sa queue translucide qui s'agitait comme une voilette dorée
et cha-toyante, ondoyant doucement et adroitement comme si le poisson avait
été une danseuse.
"Tu crois qu'il nous voit?"
"Certains mouvements peut-être."
Le dispositif d'oxygénation dans le coin de l'aquarium bourdonnait
irrégulièrement, comme le bruit du vent ou d'une clochette. La lampe de
l'aqua-rium frappait la surface de l'eau, d'où elle se reflétait sur nos
vi-sages penchés en avant.
"Écoute, à propos de ce voyage," fit mon ami. "Je ne crois pas que ce soit
une bonne idée, après tout."
"Comment ça?" demandai-je. Il parlait d'un projet dont nous discutions
de-puis longtemps: un voyage à Assise.
"Il faut encore que j'y réfléchisse."
"Tu ne veux donc plus y aller?"
"Ce n'est pas ce que je veux dire," fit-il en promenant lentement des
doigts distraits dans l'eau. Le poisson rouge monta les observer en remuant
la queue, de sorte que l'eau, agitée par ses nageoires, se refléta sur les
joues de mon ami en les marbrant d'une lumière miroitante, comme si nous
nous tenions dans l'eau d'une rivière sous un ciel d'été.
Je voulais demander "Que veux-tu dire?" afin de crever l'abcès au plus
vite. Mais parler était devenu un effort insupportable.
Il leva les doigts; des gouttelettes retombèrent dans le paysage aquatique
où des coquillages rougeâtres avaient été disposés avec soin et où de
minces ro-seaux se courbaient élégamment comme si un vent soufflait.
"Je vais encore arroser les plantes à l'étage," dit-il en refermant le
cou-vercle de l'aquarium.
"Je t'attends ici," fis-je.
Je regardai son dos s'éloigner dans l'escalier. De la petite image en noir
et blanc, le crépuscule se mit à inonder la pièce en s'élargissant comme
une onde concentrique.
Le vide aveuglant du premier printemps s'étalait devant moi. C'était une
table couverte d'une nappe immaculée où étaient disposées les assiettes
vides de jour-nées solitaires.
Le poisson remua brusquement la queue et j'eus envie de lui dire: "Tu ne me
connais pas."
"Tu ne me connais pas." Comme je m'empressais de saisir, en guise de
bé-quille, le réconfort secret de tous les délaissés. "Tu ne me connais
pas. Si tu me connaissais, si tu savais qui je suis vraiment, tu m'aimerais
à ja-mais."
Lorsqu'il revint, l'arrosoir vide à la main, il me regarda attentivement
avant de dire:
"Je crois que je ferais mieux d'éteindre la lampe de l'aquarium."
LA CHAMBRE VIDE
"Rien n'existe," dit l'Enfant-Miroir.
Il entre dans ma chambre et son doigt se tourne vers ma table.
"Hé," m'écrié-je, "j'ai encore beaucoup de travail à faire."
Il ne paraît pas m'entendre. Il a déjà réussi à dire: "La table n'existe pas."
Puis il regarde le tableau que j'ai accroché au mur. C'est une toile
magni-fique. Je la connais bien et j'aime la contempler.
"Écoute," commencé-je, mais son doigt est déjà pointé dans cette
direc-tion. "Le tableau n'existe pas."
Ça me déprime un peu. J'ai envie de m'asseoir, mais lorsque je regarde
au-tour de moi, je vois que l'Enfant-Miroir désigne déjà ma chaise.
C'était une bonne chaise. Je m'y étais assise pendant des années.
"Je ne veux pas dormir par terre," lui dis-je d'un ton sévère, mais ce
n'est pas la peine. Si rien n'existe, pourquoi devrait-il épargner mon lit
Je vois que son regard se tourne vers la lampe à présent.
"Non," lui dis-je. "Je veux voir."
Mais la lampe s'est déjà éteinte.
Nous voici donc accroupis dans l'ombre; plus rien n'existe nulle part,
si-non nous deux.
Mais il me semble apercevoir dans l'obscurité une sorte de petite
ba-guette c'est son joli doigt pâle et fin.
Oh, je sais déjà, je comprends!
Il se tourne lentement en direction de mon coeur, et je ne vois rien qui
puisse me servir de bouclier.
LE CORDEAU DE ZOROBABEL
Doña Quichotte, qui s'était penchée loin à la fenêtre, réapparut
com-plètement dans la pièce. Je vis qu'elle portait une paire de jumelles
dans les mains et que, pour quelque raison, elle était fort agitée.
"C'est bien cela," grommela-t-elle. "Pas le moindre doute."
Elle me passa les jumelles en ajoutant: "Regarde donc. Là, là sur le toit,
tu vois?"
Même à l'oeil nu on voyait clairement au loin deux hommes gravir un toit de
tuiles rouges. Pour ma part, je ne voyais rien là d'inhabituel; il existe
bien après tout des ramoneurs, des couvreurs et des ouvriers chargés de
dé-barrasser la neige.
Lorsque j'examinai les deux hommes à travers les jumelles, je vis qu'ils
étaient reliés à une longue corde de couleur claire, peut-être un mètre à
ru-ban, qu'ils déplaçaient le long de l'arête du toit.
Ce spectacle ne provoqua aucune agitation en moi.
"Il me semble," dis-je à Doña Quichotte, "qu'il sont en train de mesurer
quelque chose. On va sûrement bientôt rénover le toit."
"Bien sûr qu'ils sont en train de mesurer," concéda-t-elle. "C'est
exacte-ment ce qu'ils font. Mais j'en sais davantage. Car je connais le nom
de leur instrument de mesure."
"Tu le connais?" fis-je, interloquée. "Comment cela est-il possible?"
"Il se trouve que je l'ai lu ce matin juste après mon réveil. C'est le
cor-deau de Zorobabel."
Elle alla chercher un livre à couverture noire dans sa bibliothèque et se
mit à lire:
'Levant les yeux, je regardai; je vis un homme ayant à la main un cor-deau
d'arpenteur.
'Je l'interrogeai: &laqno;Où vas-tu?» - &laqno;A Jérusalem,» répondit-il, &laqno;pour en
dé-ter-miner la largeur et la longueur.»
'L'ange porte-parole s'éloigna, et un autre ange vint à sa rencontre, qui
lui dit: &laqno;Cours! Parle à ce jeune homme. Dis-lui: Jérusalem va rester sans
rempart, tel-lement elle contiendra d'hommes et de bétail.»'
Doña Quichotte lisait d'une voix grave et pénétrante et me jetait un
re-gard acéré chaque fois qu'elle désirait insister sur un mot particulier.
'Pourquoi donc sourire de ces petits débuts? On se réjouira de voir
Zorobabel, le fil à plomb à la main. Ces sept yeux, ce sont les yeux du
Seigneur: ils parcourent toute la terre.'
Elle referma brusquement le livre.
"Qu'en dis-tu?"
"Euh On dirait en effet"
"'On dirait en effet, on dirait en effet,'" me singea-t-elle. "Quand donc
tes oreilles s'ouvriront-elles? Et tes yeux?"
"Il y a quelque chose qui ne joue pas là aussi?"
"Tu me regardes avec des yeux froids et sceptiques," dit Doña Quichotte
d'un ton accusateur. "Les yeux du monde. Où as-tu dissimulé les tiens?"
"Je ne sais pas encore lesquels sont les miens, Doña Quichotte," fis-je, un
peu piteuse. "Il y en a tellement, des yeux. Bien plus de sept."
"Il est temps de choisir," dit-elle lentement. "Vraiment, il est grand temps.
"Qui plus est," reprit-elle d'un ton enflammé, "ne viens pas me par-ler d'yeux."
Je restai silencieuse.
"Pas d'yeux," fit-elle. "Non, pas d'yeux, mais du regard qui voit"
Ses paupières se fermèrent.
"Comme il fait clair aujourd'hui! Aujourd'hui, aujourd'hui aussi est le
jour des petits commencements Va regarder si l'on voit encore Zorobabel
là-bas."
J'allai jeter un coup d'oeil à la fenêtre.
"Non, il est parti."
Et Doña Quichotte refusa de parler davantage de Zorobabel.
Lorsque nous sortîmes pour aller manger, il commençait déjà à faire noir.
Dans les dernières lueurs du soir, un étroit croissant de lune flottait
au-des-sus des toits, et il s'était mis à geler.
Dans la rue que nous longions, presque toutes les fenêtres étaient
éclai-rées, de même que dans la rue perpendiculaire et sur la place où elle
abou-tissait. On au-rait dit que la ville entière, cernée par l'obscurité,
était restée à la maison ce soir-là.
"Il y a tant de gens là, tant de gens" me sembla-t-il entendre Doña
Quichotte murmurer, tandis que la pellicule de glace qui recouvrait les
flaques craquait sous nos pas et qu'un cercle de lumière après l'autre
glissait vers nous.